Nuit du littoral – Lancement de la concertation pour un plan guide du littoral – Ville de Marseille
29 AVRIL 2025 _ PARC CHANOT
Intervention de Véronique Mure
C’est là, à cette interface entre terre et mer, que tout a basculé, que tout s’est accéléré́. Aucune trace de ça, mais pourtant la mémoire d’une des étapes originelles de la vie sur la planète est bien là. Chaque rivage incarne symboliquement ce temps initial où le règne végétal a émergé et s’est terrestrialisé, il y a environ 470 millions d’années, à l’Ordovicien.
Si on met ce temps-là en rapport avec l’existence d’Homo sapiens, notre espèce, estimée à 300 000 ans, on trouve un facteur multiplicateur de plus de 1500. Les plantes ont passé 1500 fois plus de temps que nous sur la planète.
Toute une vie qui est juste là, près de nous, mais que nous ne voyons pas. Très souvent, à force de quotidienneté, nous la pensons sans importance, voire banale. Par exemple, nous sous-estimons, ou ignorons, le rôle crucial que les végétaux ont eu sur la formation des sols ou sur l’évolution de l’atmosphère, ceci ayant permis de rendre notre planète habitable.
Et ce que nous percevons encore moins, c’est que, depuis lors, toutes les grandes acquisitions du règne végétal (photosynthèse, système racinaire des plantes vasculaires, fleurs et fruits des angiospermes…) se sont faites en coévolution avec un autre règne du vivant (avec des cyanobactéries pour la photosynthèse, avec les champignons comme précurseur des racines des plantes vasculaires – c’est la mycorhization dont on parle tant aujourd’hui – avec le règne animal, insectes et oiseaux notamment, pour la pollinisation des fleurs et la dissémination des fruits …). Le « vivre ensemble », entre tous les règnes du vivant, voilà la preuve, si besoin était, de l’intelligence des plantes.
Mais descendons dans les échelles spatiales et temporelles pour revenir à Marseille et à son actualité.
Et avant de poser tout à fait le pied sur ce littoral qui nous occupe ce soir, je voudrais dire un mot sur la Méditerranée. J’aime bien rappeler que le qualificatif de « méditerranéen (ou méditerranéenne) » s’applique indifféremment à une mer, à un peuple, à un climat, ou à une végétation et que tous sont liés par cette « méditerranéité ». Je n’ai pas le temps de lire un texte entier de Giono sur le sujet, car les minutes me sont comptées,[i] mais je voudrais dire juste ces quelques mots :
« sur cette eau, depuis des millénaires, les meurtres et l’amour s’échangent et un ordre spécifiquement méditerranéen s’établit »

Je voudrais également m’arrêter 30 secondes sur ce climat méditerranéen qui a cette particularité, unique, de marier le sec et le chaud dans la même saison estivale. Dans tous les autres climats du monde, hormis dans le climat désertique, la saison chaude est la saison des pluies et la saison sèche est la saison froide. Pourquoi est-ce si important d’être conscient de cette particularité ? Et bien parce que, ce que l’on appelle la mauvaise saison dans le climat méditerranéen, c’est l’été. Les cycles de vie des plantes vont être conditionnés par cette saisonnalité-là, se mettant au repos non pas durant les mois d’hivers mais durant les mois d’été. Maintes autres adaptations vont en découler (feuillages persistants en hiver pour rester actif, feuilles petites et coriaces pour mieux gérer le manque d’eau en été, systèmes racinaires puissants pour aller chercher cette eau précieuse au plus profond des sols ou de la roche…).
Parmi les adaptations typiquement méditerranéennes il y a celles des pyrophytes, des plantes non seulement adaptées au passage du feu, mais qui parfois le favorise (on dit qu’elles appellent le feu) car elles en ont besoin pour se reproduire. Le pin d’Alep est de celles-là. Sans le feu ses graines ne germent pas ou moins bien. Ce pin d’Alep dont j’ai pu dire qu’il barbouillait nos paysages méditerranéens, arbre pionnier s’il en est, est d’une efficacité redoutable pour reconquérir les terres après un feu ou un abandon.



On atterri un peu brutalement, j’en conviens, sur le littoral. Mais on est au cœur d’une réalité sur laquelle il faut ouvrir les yeux : les accrues forestières d’une part et les changements climatiques de l’autre, génèrent un risque important de méga feu.
Et c’est un paradoxe, car cet « enforestement » spontané et la présence des arbres, que nous appelons de nos vœux pour maintenir la ville habitable et favoriser la biodiversité urbaine, peut aussi être perçu comme une vulnérabilité du territoire. Selon qu’on est pompier, naturaliste ou habitant, notre regard sur lui sera différent.
Continuons à descendre des échelles pour arriver sur la frange littorale, à proximité de l’eau. Une frange sous influence du sel et des embruns.
C’est là que l’on va commencer à se munir de loupes, pour regarder au plus près de la végétation halophile ou halophyte, selon qu’elle tolère le sel ou en est dépendante. Beaucoup de plantes y sont précieuses, protégées, comme la bien nommée Astragale de Marseille (Astragalus tragacantha) ou comme l’Anthemis secundiramea, cette petite marguerite au drôle de nom d’Anthémis à rameaux tournés d’un même côté, ou encore la toute petite saladelle qui se blottie dans le creux des rochers, (Limonium minutum), tout comme le plantain caréné (Plantago subulalta). Il n’est pas question d’énumérer ici toutes les plantes du littoral marseillais mais plutôt de vous faire toucher du doigt ses spécificités.






Du haut de l’échelle on ne comprend rien de la finesse du fonctionnement des milieux littoraux, mais si l’on s’en rapproche, on s’apercevra que de nombreux habitats s’y succèdent à quelques encablures de la mer. Pour chacun, l’influence marine, la force du vent et des embruns, la teneur en sel, la disponibilité en eau… varient assez pour former des milieux significativement différents, occupés par des associations végétales spécifiques, les phryganes en tête, avec leurs plantes en coussinets, formant de vastes paysages sculptés par les vents.

Il est donc essentiel d’observer et surtout de comprendre comment fonctionne la vie littorale pour un aménagement respectueux de ce vivant. Ouvrir les yeux sur chacune de ses spécificités, faire du génie naturel et des dynamiques du vivant des forces du projet, sont des urgences pour que la ville soit accueillante pour tous.
En terminant mes interventions publiques, je demande souvent aux personnes face à moi de faire ce petit exercice : visualisez mentalement un arbre dans la ville, imaginez-vous être cet arbre…. Pourriez-vous vivre sa vie d’arbre dans les conditions qui lui sont offertes ?
[i] « Cette mer ne sépare pas, elle unit. Aux peuples de ses rivages, bien que de races différentes, de religions opposées, elle impose les mêmes gestes. L’Espagnol des sierras montera son âne comme le Libanais ; le gauleur d’olives du Var frappe son arbre comme le gauleur d’olives de Delphes ; on voit près d’Aigues-Mortes les mêmes mirages de chaleur que près d’Alexandrie d’Egypte ; les pêcheurs de thon de Carro traînent leur madrague en chantant les chansons que chantent les pêcheurs de Tyr ou de Péluse ; c’est du même pied, semble-t-il, qu’ont été animés les tours qui ont arrondi les jarres de la Crète et celles des Baléares et de Tanger ; en août, Marseille dort comme dormait Carthage ; Carthagène fait sécher ses raisins comme Rhodes.
J’ai longtemps trouvé dans les collines autour de Manosque le décor de l’Orestie ; tel vallon au nord de Sainte-Victoire semble avoir été décrit par Sinbad le marin ; ce laboureur est dans Théocrite ou dans Virgile ; ce piégeur de grives est dans l’histoire arabe de Tabari ; ce marchand de porcs de Draguignan a la ruse d’Ulysse ; ce charretier andalou boit à la cruche d’argile comme buvait Haroun al Rachid. Il n’est pas jusqu’aux morts qui ne soient pleurés du même thrène et le vocero a les mêmes inflexions que les gémissements berbères.
Ce n’est pas par-dessus cette mer que les échanges se sont faits, c’est à l’aide de cette mer. Mettez à sa place un continent et rien de la Grèce n’aurait passé en Arabie, rien de l’Arabie n’aurait passé en Espagne, rien de l’Orient n’aurait passé en Provence, rien de Rome à Tunis. Mais sur cette eau, depuis des millénaires, les meurtres et l’amour s’échangent et un ordre spécifiquement méditerranéen s’établit. »
Jean GIONO, Provence (1959 / Gallimard, collection Folio)

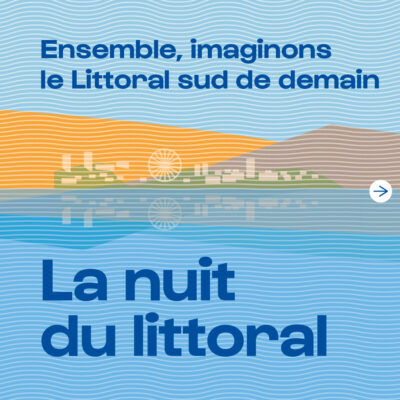


Il n'y a pas de commentaires